face à l'esprit de création. Fagne avait sacrifié ses travaux personnels au profit de l'oeuvre de ses contemporains. Il avait souvent donné un coup de pouce à un poète de langue néerlandaise en le traduisant pendant qu'il en faisait la lecture. Septentrion a publié de lui en 1976 (no. 1) la traduction de quelques sonnets du poète flamand Maurice Gilliams dans laquelle Fagne exprime l'essence du vers avec l'élégance et la sobriété de l'homme inspiré, sans les béquilles de l'écriture de base. Infidélité au texte d'origine? Non, Henry Fagne comme tant d'autres traducteurs de poésie, affirmait les limites de la traduction en laissant l'auteur maître du destin du poème, tout en lui choisissant un endroit de refuge approprié.
Cette réflexion me remet en mémoire la farce bien innocente dont je me rendis coupable dans mes jeunes années. A un poète belge d'expression française je demandai un jour ce qu'il pensait de la traduction suivante:
La mort grande, du fond des sonnantes armoires De l'orgue, érige en chant de gloire, immensément, Vers les voûtes, le nom du vieux Ruwaert flamand Dont chaque anniversaire exalte les mémoires.
J'ajoutai que le poème entier était écrit à la gloire d'Artevelde. Il me fit relire la strophe, hocha la tête et conclut que c'était-là de la vraie poésie, mais qu'on humait de prime abord la traduction. Je n'eus pas le courage d'avouer que les vers étaient d'Emile Verhaeren.
Le peintre néerlandais Bessel Kok et sa femme française la céramiste Marie-France Kok Adam participent chaque année à la belle saison à l'organisation de vacances insolites en Rouergue. De quoi s'agit-il? De joindre, pour le citadin en congé payé, l'utile à l'agréable, le travail à l'atelier ou dans la nature, sous la direction d'un artiste, tout en se livrant aux formes multiples des distractions vacancières coutumières dans le département de l'Aveyron. L'atelier du couple à Marnhac par Saint Géniez d'Olt est le lieu d'accueil d'apprentis artistes qui peuvent courir des stages de 2, 3 ou 4 semaines et repartir, si le talent a donné des fruits généreux, avec un album de croquis, de dessins, de gouaches, de pastels, d'aquarelles, de collages ou de peintures à l'huile, comme au bon vieux temps du carnet de voyage.
Ces vacances insolites se pratiquent à travers le Rouergue tout entier et la bosse artisanale est favorisée aussi bien en dinanderie qu'en peinture sur soie, en tissage, en poterie, en vannerie, qu'en céramique, sculpture, fer forgé ou travail du cuir. Mais là ne s'arrête pas la liste des possibilités insolites pour le vacancier en mal d'activité. Il peut changer de violon d'Ingres au cours des ans et pratiquer successivement la fabrication de petits meubles ou autres travaux d'ébénisterie,
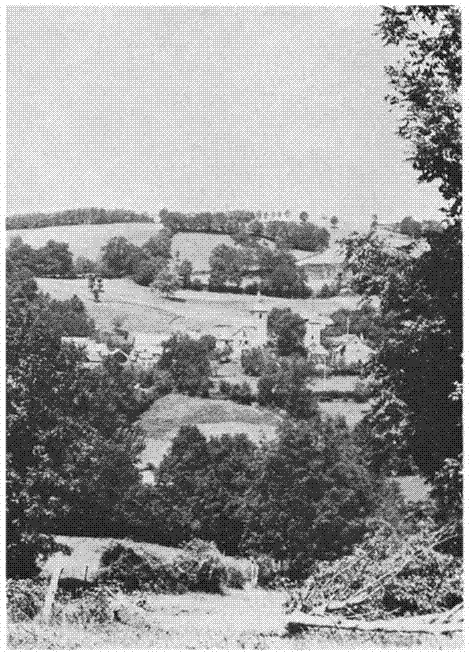
Vacances insolites en Rouergue avec un couple d'artistes néerlandais dans la vallée du Lot ou avec cent autres artisans de Rouergue.
comme il peut troquer les stages d'histoire de l'art, de musique, de danse et d'art dramatique avec l'étude de la géologie, de la botanique, des plantes médicinales, ou encore s'adonner à la connaissance du cheval ou de la vie à la ferme, aux problèmes de mécanique automobile ou de façonnage de marionnettes. Une heureuse initiative missionnaire. Le fanatisme des vacanciers insolites tourne le dos à l'Europe de la discorde et des massacres. Charlemagne fit couper la tête de 4500 Saxons en l'an de disgrâce 782 ‘parce qu'ils ne pensaient pas comme lui’. Bessel Kok et ses semblables parlent, ai-je cru comprendre, le langage fraternel et bon enfant du geste des travailleurs.