La philosophie française en Flandre et aux Pays-Bas
La concurrence quasi permanente que, tant en Flandre qu'aux Pays-Bas, se font philosophes anglo-saxons et français en vue d'y tenir le devant de la scène, a longtemps tourné à l'avantage des derniers. Cette prépondérance française ne saurait évidemment nous faire oublier l'influence exercée par les grands penseurs allemands du
xxe siècle: Max Scheler (1874-1928), Edmund Husserl (1859-1938), Karl Jaspers (1883-1969), Martin Heidegger (1889-1976) et Jürgen Habermas (
o1929). A l'exception du dernier, tous ont d'ailleurs influencé la philosophie française moderne elle-même, notamment à la suite de l'intérêt que l'université de Louvain devait manifester, dès 1945, pour l'oeuvre de Husserl et de Heidegger. Les cours et études approfondies consacrés à Heidegger, les traductions françaises qu'il fit de certaines de ses oeuvres, valurent à l'Anversois Alphonse de Waelhens (1911-1981), à l'époque
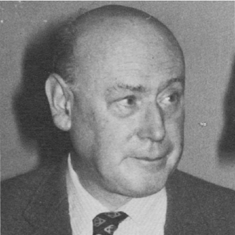
A. de Waelhens (1911-1981).
professeur dans cette même université, un rayonnement considérable auprès du public français. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, de Waelhens s'efforça de faire de Louvain un véritable lieu de rencontre entre philosophies allemande et française, puissamment épaulé en cela par Herman van Breda (1910-1974). Celui-ci avait réussi, à la veille de la guerre, à transférer à Louvain les archives complètes d'Edmund Husserl, les préservant ainsi de la frénésie destructive antijuive des nazis. Du coup, l'Institut Supérieur de Philosophie de Louvain devint un centre d'études très recherché.
Ce fut précisément la pensée de Husserl et de Heidegger, autrement dit la phénoménologie moderne, qui attira la jeune génération des philosophes français: Jean-Paul Sartre (1905-1980), Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), Emmanuel Levinas (o1905), Paul Ricoeur (o1913), Jacques Derrida (o1930). Certains d'entre eux vinrent effectuer des recherches à Louvain où se trouvait à cette époque une colonie assez nombreuse d'étudiants néerlandais, en majorité catholiques, venus se former ou se perfectionner en philosophie et par le biais desquels la percée de la jeune pensée française aux Pays-Bas ne tarderait pas à s'opérer.
Il va de soi que l'université de Louvain était loin de monopoliser la nouvelle philosophie française. Certains, tels que Bernard Delfgaauw (o1912), l'avaient déjà découverte à la faveur d'initiatives personnelles. Peu après la fin de la guerre, celui-ci entra en contact avec les cercles philosophiques français et consacra une thèse de doctorat à l'oeuvre de Louis Lavelle (1883-1951), philosophe aujourd'hui quelque peu relégué au purgatoire, semble-t-il, mais à l'époque apprécié pour la finesse et l'acuité de sa pensée existentielle. Il étudia